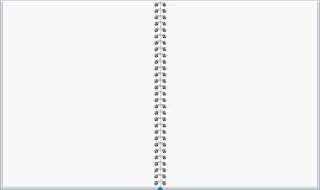Durant l’année 2012 j’ai décidé de publier ici même chaque
semaine un billet exprimant mon ressenti personnel sur la semaine précédente,
dans la perspective, bien évidemment, des problématiques de la prospective du
livre et de l’édition.
Ce post est donc le 29/52.
La voix de son maitre
 Je me souviens ces pochettes de disques vinyle avec ce label : La voix de son maître.
Je me souviens ces pochettes de disques vinyle avec ce label : La voix de son maître.
Qui sont les maitres aujourd’hui ?
De tels disques et les machines pour les lire et les
disquaires ont disparu. Comme par un mauvais enchantement. Et malgré cela qui
aujourd’hui, au cœur de l’été 2012, a conscience de la guerre économique qui se
déchaine pour le contrôle du marché du livre francophone ?
Quelques jours à peine après le naufrage annoncé du portail
de la librairie indépendante 1001libraires et le sabordage de ses affidés,
Google a lancé, le 18 juillet, son programme de vendeur de livres.
Trois armées donc sont maintenant dans la place :
Amazon, Apple, Google.
L’édition française a-t-elle un autre choix que celui de la
collaboration ?
Avec la digitalisation du livre et la multiplication de
nouveaux dispositifs et de nouveaux services de lecture, aussi imparfaits et
discutables soient-ils, le marché du livre se reconfigure.
Un tel remembrement ne pourra se faire pour le bénéfice de
tous.
Nous pouvons nous demander au détriment de qui il se fera ?
Des libraires seulement ? Seulement ?
L’état des lieux au 22 juillet 2012 n’est-il pas révélateur
d’une forme de soumission dans l’inconscient national à un modèle de réussite à
l’américaine ? Et également d’un type de fonctionnement (se faire financer
avec l’argent des contribuables par les gouvernements successifs) qui ne
fonctionne pas ?
Amazon ; Apple ; Google. Trois coups de glas dans
notre nuit d’encre et de papier mâché.
Les salariés français de ces entreprises américaines sont
logiquement anglophones et, outre qu’ils adoptent tout aussi logiquement la
conduite la plus propice au développement de leurs carrières professionnelles,
ils sont aussi probablement influencés par le génie de la langue qu’ils
manipulent : sans doute les manipule-t-elle davantage.
Le conflit non avoué et qui pourtant fait rage, n’est pas
entre les “éditeurs papier” et les “éditeurs pure-players” — que j’ai définis ainsi en
avril 2011 : « Un éditeur pure-player est un entrepreneur qui
publie des livres exclusivement dans des formats numériques à destination des
nouveaux dispositifs de lecture. », le conflit est entre
l’interprofession du livre, dans son ensemble, et certaines industries
numériques américaines. Mais ces dernières notamment n’ont pas intérêt à ce que
ces choses soient ainsi perçues, alors elles font en sorte qu’elles ne le
soient pas.
Ce qui fait image
Autre chose alors… Je me souviens m’être arrêté parfois dans
mes lectures, violemment surpris par la force d’une image, par une impression de
lecture si forte, si intense, comme émerveillé face à l’acmé qu’en une
milliseconde avait atteint ma visualisation d’un paysage, d’une
atmosphère ; il s’agit alors d’une vraie chance, d’un phénomène d’une
intensité tellement surprenante que cela me réveillait en quelque sorte de ma
lecture. Je relisais alors la ou les quelques phrases concernées et qui avaient
été les déclencheurs de cet état rarement perceptible, qui d'ordinaire s’écoule
naturellement dans le plaisir de lire.
Et de fait souvent je passe ainsi, emporté par le flot de ma
lecture et me laissant transporter avec abandon, cet abandon que je rechercherais
précisément dans la lecture, le ressentant sans doute trop dangereux dans la
“vraie vie”.
Mais d’autres fois je m’arrête, je reviens en arrière dans
ma lecture, juste de quelques lignes, de quelques phrases, rarement plus loin,
pour y repartir en goûtant alors davantage cet instant, tout au plus en
m’appliquant à prendre, juste la petite minute de cette relecture, une respectueuse
distance critique sur la construction, les choix de l’auteur, sur ce qui a si
fortement fait image en moi. Et finalement, c’est seulement de rares fois où
j’ai réellement marqué un véritable temps d’arrêt, me disant qu’il allait
falloir que je recopie une phrase précise, pour un jour réfléchir vraiment au
phénomène, et puis… je reprends en fait ma lecture. Et puis… Et puis le temps
passe, le livre noie la phrase en question, je ne m’en souviens plus, je ne la
retrouve plus… Je suis oublieux.
 C’est la raison pour laquelle je n’ai aujourd’hui qu’un seul
exemple pour illustrer mon propos. Le voici…
C’est la raison pour laquelle je n’ai aujourd’hui qu’un seul
exemple pour illustrer mon propos. Le voici…
Il y a quelques années, deux, trois, l’on m’a offert un beau
roman d’une auteure russe contemporaine : Olga Slavnikova. Dans ce roman
titré 2017, j’ai, je crois, plusieurs fois ressenti ce phénomène,
favorisé sans doute par le décor spectaculaire présentant des gisements de
pierres précieuses dans les montagnes de l’Oural et la dimension mythologique
du récit, peut-être en partie prophétique (2017 c’est dans moins de cinq
ans !).
Aussi ai-je fait récemment l’acquisition du premier livre d’Olga
Slavnikova à avoir été traduit en français (aux éditions Gallimard) : L’Immortel.
Ce bref extrait, que nous pourrions titrer : Après
la pluie, ou bien, Le cycliste, peut, je l’espère, éclairer
l’expérience de lecture à laquelle je fais référence :
« Le soleil venait de se montrer, les flaques sur
l’asphalte humide et bleu ressemblaient à des fenêtres lavées de frais. Un
cycliste blond passa dans un clapotis éblouissant de roues, penché sur son
guidon comme un oiseau en vol, translucide de lumière jusqu’aux rayons de son vélo
et à son coupe-vent bruissant à l’éclat de vitrail grossier. ».
 Ici, et bien plus encore lorsque pris dans le courant de la
lecture, l’instantané rend la scène avec un réalisme qui m’apparaît indéniable.
Et pourtant… Si nous nous arrêtons et essayons de visualiser effectivement les
passages que je souligne maintenant : « Le soleil venait de se
montrer, les flaques sur l’asphalte humide et bleu ressemblaient à des fenêtres
lavées de frais. Un cycliste blond passa dans un clapotis éblouissant de
roues, penché sur son guidon comme un oiseau en vol, translucide de
lumière jusqu’aux rayons de son vélo et à son coupe-vent bruissant à
l’éclat de vitrail grossier. ».
Ici, et bien plus encore lorsque pris dans le courant de la
lecture, l’instantané rend la scène avec un réalisme qui m’apparaît indéniable.
Et pourtant… Si nous nous arrêtons et essayons de visualiser effectivement les
passages que je souligne maintenant : « Le soleil venait de se
montrer, les flaques sur l’asphalte humide et bleu ressemblaient à des fenêtres
lavées de frais. Un cycliste blond passa dans un clapotis éblouissant de
roues, penché sur son guidon comme un oiseau en vol, translucide de
lumière jusqu’aux rayons de son vélo et à son coupe-vent bruissant à
l’éclat de vitrail grossier. ».
Si l’on s’arrête sur les détails qui fondent l’effet tout
semble se désunir. C’est sans doute la composition d’ensemble qui rend bien, qui
sonne juste, qui fait image, un peu comme les touches de pinceaux sur une toile
impressionniste. A quelques mètres, vous êtes subjugué, immergé dans le paysage
représenté ; à quelques pas, vous n’en voyez plus qu’un magma peinturluré
de grossières taches multicolores (cf. illustration 1). Mais au final l’effet
produit à la lecture semble réel, bien parfois qu’aussi improbable, tout en
restant possible, que la fameuse scène de rue peinte par Balthus (cf.
illustration 2).
Je le redis, de nombreux autres exemples auraient mieux
rendu ce dont j’aurais souhaité parler aujourd’hui (je pense notamment chez
Bernanos…). Et il faut aussi tenir compte ici, dans cet exemple, qu’il s’agit
d’une traduction (de Christine Zeytounian-Beloüs) du russe. (J’ai récemment eu
plusieurs expériences fortes qui m’ont secoué concernant des traductions, et
sur lesquelles je devrais certainement aussi réfléchir davantage…)
Les technologies du numérique et les nouveaux rapports à la
lecture qu’elles instituent pourraient au cours de cette décennie fondre
l’ensemble des arts narratifs dans une seule et même geste, aussi ample que des
bras ouverts ; une geste de création bien plus fluide que du transmédia simplement
réticulé.
Il suffirait, pour comprendre ce à quoi je fais allusion, de
remplacer dans le poème Correspondances de Charles Baudelaire, pour
celles et ceux à qui la lecture est naturelle, “Nature” par “lecture” :
« La [lecture]
est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois
sortir de confuses paroles ;
L'homme y passe à
travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec
des regards familiers.
Comme de longs échos
qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et
profonde unité,
Vaste comme la nuit et
comme la clarté,
Les parfums, les
couleurs et les sons se répondent. »
Voilà la raison pour laquelle ces impressions de lecture et
leur devenir au cours de ce siècle ont bien plus de poids finalement qu’une
bataille gagnée par Google ; et voilà pourquoi aussi, parce que je pense
cela, parce que je pense ainsi, voilà pourquoi ces gens-là, de Google et les
autres, me méprisent certainement. Je m’en réjouis, je m’en réjouis, qu’ils le
sachent ! Je m’en réjouis. (Mais cela pose aussi la question de savoir si
ce que j’appelle : “les impressions de lecture”, sont liées, ou pas, à
l’impression du texte ? Grave question ; dont la réponse serait
peut-être à chercher du côté des peintres ?)
 "Dans le fond, un texte obscurcit cette immense portion du monde auquel il ne s'intéresse pas ; et il la recouvre d'une couche de plâtre ; aux images que nous avons du monde, il substitue celles, propres et exclusives, de son univers possible, de sorte qu'avec beaucoup d'attention et un grand effort de l'esprit, elles s'impriment [sic] et dominent dans notre imagination. Cela fonctionne mieux encore si nous lisons le texte (ou le regardons, si c'est un texte visuel) comme si nous nous isolions avec lui et en lui "dans les ténèbres et dans la quiétude de la nuit", de sorte que "l'idée vive et intense" des nouvelles images "chasse les premières Idées". Un texte, dans la mesure où il nous absorbe, fait place nette du monde qui existait avant lui, dont il ne parle pas, auquel il ne fait aucune référence, comme si son discours était "une grande tempête de vents, de grêles, de poussières, qui ruine et inonde maisons, temples et lieux, qui confonde toute chose", comme s'il était, par rapport au monde extérieur, "un Homme ennemi... [qui] avec un groupe de compagnons armés, entre et passe impétueux à travers les Lieux, et avec des fouets, des bâtons et des armes chasse les idoles, frappe les personnes, fracasse les images, fasse fuir par les portes et sauter par les fenêtres tous les animaux et les personnes mobiles qui étaient dans les lieux" ; et qu'il nous présente à la fin un autre univers, à sa façon..."
"Dans le fond, un texte obscurcit cette immense portion du monde auquel il ne s'intéresse pas ; et il la recouvre d'une couche de plâtre ; aux images que nous avons du monde, il substitue celles, propres et exclusives, de son univers possible, de sorte qu'avec beaucoup d'attention et un grand effort de l'esprit, elles s'impriment [sic] et dominent dans notre imagination. Cela fonctionne mieux encore si nous lisons le texte (ou le regardons, si c'est un texte visuel) comme si nous nous isolions avec lui et en lui "dans les ténèbres et dans la quiétude de la nuit", de sorte que "l'idée vive et intense" des nouvelles images "chasse les premières Idées". Un texte, dans la mesure où il nous absorbe, fait place nette du monde qui existait avant lui, dont il ne parle pas, auquel il ne fait aucune référence, comme si son discours était "une grande tempête de vents, de grêles, de poussières, qui ruine et inonde maisons, temples et lieux, qui confonde toute chose", comme s'il était, par rapport au monde extérieur, "un Homme ennemi... [qui] avec un groupe de compagnons armés, entre et passe impétueux à travers les Lieux, et avec des fouets, des bâtons et des armes chasse les idoles, frappe les personnes, fracasse les images, fasse fuir par les portes et sauter par les fenêtres tous les animaux et les personnes mobiles qui étaient dans les lieux" ; et qu'il nous présente à la fin un autre univers, à sa façon..."